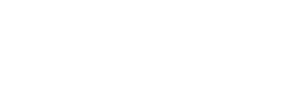Des moyens simples à la disposition des salles de rédaction afin de protéger les journalistes contre l'exposition à des traumatismes
Un billet de Dave Seglins • 20 novembre
Voici trois solutions, mais d’abord, une histoire.
Il y a deux ans, au plus fort du confinement lié à la pandémie, on m’a confié la couverture d’un drame irrésolu: l’enlèvement, l’agression sexuelle et le meurtre d’une jeune fille.
Mon estomac s’est noué.
«N’y a-t-il personne d’autre pour couvrir cette histoire» ai-je demandé?
Je pataugeais déjà dans les histoires morbides, portant sur des gens morts au travail, ou encore des suites de la Covid. J’étais aussi en télétravail, confiné à la maison avec deux préados qui faisaient l’école à distance, et qui captaient à l’occasion des bribes de mon travail.
Malheureusement, il n’y avait personne d’autre pour couvrir l’histoire.
Alors j’ai fait ce que nous faisons tous: j’ai avalé la pilule et j’ai embrayé en vitesse supérieure. Le soir même, j’avais une histoire prête pour le bulletin national de nouvelles radio.
Mais le lendemain, on m’a de nouveau affecté à cette histoire de meurtre datant de 1984. J’ai dit à mon patron que je ne pouvais tout simplement par le faire. Que cette histoire m’affectait trop profondément.
«Tu ne peux pas refuser une affectation» m’a-t-il dit. «Ce n’est pas comme ça que ça fonctionne. Si tu ne peux pas faire ce genre d’histoires, peut-être devrais-tu considérer un changement de carrière.»
J’étais terrassé. Je me sentais dépassé, c’est clair, mais je savais aussi que ce n’était pas un état permanent, que je n’étais pas malade. Et je n’avais aucune intention de quitter le journalisme.
De plus, j’étais un peu blessé parce que mon patron était un ami et un pair. Nous avons grandi ensemble dans le tumulte et l’effervescence des salles de nouvelles.
Le pupitre a finalement trouvé quelqu’un d’autre pour courir l’histoire, et le ciel ne s’est pas effondré.
Après une fin de semaine à ruminer cet événement, je suis retourné voir mon patron et je lui ai dit: «C’est exactement comme ça que ça devrait se passer! Un employé en difficulté devrait pouvoir lever la main et exprimer ses inquiétudes pour sa santé lorsqu’il est affecté à une histoire traumatisante.»
J’ai beaucoup réfléchi à cet événement et à comment notre industrie couvre les traumatismes. Depuis, j’ai renoué avec mon patron/ami. Nous avons discuté de la situation ensemble et nous avons tous deux appris quelque chose.
Avec sa permission, j’utilise maintenant ce scénario dans mes formations pour parler de la dynamique dans les salles de rédaction, pour mieux comprendre les pressions auxquelles sont confrontés à la fois les journalistes et les patrons. Il me permet aussi d’illustrer le difficile équilibre entre la santé mentale d’un journaliste et la nécessité de nourrir la machine médiatique.
Il est important de tenir compte du fait que lorsqu’une nouvelle éclate, les patrons des salles de nouvelles sont soumis à d’intenses pressions, avec les émissions à remplir, le nombre limité de journaliste pour y arriver et les délais impartis. Ils veulent donc pouvoir compter sur leurs journalistes dans ces moments critiques.
Un scénario complexe, particulièrement dans l’industrie des médias, où règne une culture qui n’incite pas à parler de notre propre bien-être et de notre santé mentale. Mais voici trois idées pour nous aider à nous améliorer.
Solution #1: Un baromètre du traumatisme
Assurez-vous auprès de vos collègues qu’ils sont prêts à entendre une histoire potentiellement dérangeante ou traumatisante avant de la leur raconter. Nous sommes tous différents. Nous avons tous des bagages différents, un passé, des vulnérabilités, des niveaux de résilience qui divergent, ainsi que des façons différentes de faire face aux traumatismes.
Une façon simple d’y parvenir est de se demander, en équipe, où se situe cette histoire sur un «baromètre du traumatisme», sur une échelle de 1 à 10?
J’ai entendu parler pour la première fois de cette idée d’un «baromètre du traumatisme» par Almudena Toral, productrice exécutive en vidéo/documentaire chez ProPublica et agrégée supérieure au Centre Dart pour un journalisme tenant compte des traumatismes.
«Nous sortions d’une couverture vraiment difficile et un collège a dit à la blague que pour la prochaine histoire qu’il couvrirait, question d’avoir une pause, il aimerait qu’elle soit un 3/10 sur une échelle du traumatisme, m’a-t-elle raconté. L’idée m’est restée en tête.»
«C’est très utile avant, pendant et après une couverture, d’avoir une conversation franche sur le contenu. Il est important aussi de se demander si on est prêt à faire face à ce genre de contenu.»
Ce simple exercice permet de mettre le doigt sur des points importants, sans même avoir à faire d’examen approfondi.
D’abord, il permet, dans une simple conversation, de reconnaître qu’une histoire peut être difficile.
Deuxièmement, c’est un outil qui permet aux membres de l’équipe d’exprimer avec un simple chiffre ce qu’ils pensent d’une affectation, en fonction de ce qu’ils vivent en ce moment, de leur niveau de résilience et de leur propre niveau de confort face à ce sujet.
Troisièmement, cela permet aux équipes de s’ajuster en conséquence, surtout si un des membres de l’équipe a qualifié un sujet d’un 10 ou d’un 11 sur le baromètre du traumatisme.
Solution #2: Mot de passe «Oklahoma»
Un nouveau patron à la station de Thunder Bay de la CBC avait commencé à utiliser le mot de passe «Oklahoma» comme moyen pour les employés de confier discrètement qu’ils passaient une journée difficile. (Très Ted Lasso!)
«Je l’ai proposé à plusieurs employés de façon assez informelle en leur disant: “Hey, si tu as une mauvaise journée, fais juste dire “Oklahoma”, et je vais comprendre que tu as besoin d’une pause”, explique le producteur exécutif Alex Bockman.
«Ça a été très bien reçu, même si les employés ne l’utilisaient pas nécessairement, certains m’ont dit que de savoir que ce mot de passe existait les rassurait» dit Brockman.
«D’autres utilisaient le mot de passe. Ils venaient simplement me voir à mon bureau pour me dire qu’ils avaient “une journée de style Oklahoma”. Je savais alors que je devais garder un œil sur eux, sur leur bien-être. C’est un moyen simple, mais très efficace.»
Solution #3 Un protocole pour se retirer d’une couverture
Quel est le protocole dans votre salle de nouvelle si vous ou un collègue éprouves des difficultés et dois se retirer d’une couverture? Un tel protocole est-il même en place?
La plupart des salles de nouvelles ne disposent pas de protocole semblable. Il est temps que cela change, il est temps que les patrons commencent à en parler ouvertement.
En 2020, lors de la couverture entourant les importantes manifestations aux États-Unis dans la foulée du meurtre de George Floyd par la police, les patrons de NPR ont commencé à dire aux journalistes sur la ligne de front que s’ils avaient besoin d’une pause, où s’ils souhaitaient être retirés de l’histoire qu’ils n’avaient qu’à le dire, et que cela n’aurait aucune répercussion.
Ils se sont inspirés d’une règle non écrite qui existe déjà pour les correspondants de guerre déployés en zone de conflit. NPR a simplement appliqué le même principe aux journalistes nationaux. Si un journaliste a besoin d’aide parce qu’il est en difficulté, il n’a qu’à lever la main. C’est un protocole clair, sans ambiguïté, qui permet au personnel d’agir si jamais ils se sentent piégés dans une histoire, s’ils sont dépassés, épuisés ou blessés par l’exposition à des événements traumatisants.
Une compréhension nouvelle et évolutive de l’impact des événements traumatisants est actuellement en développement. En 2013, l’Association psychiatrique américaine a redéfini les facteurs de risque pour le TSPT (Trouble de stress post-traumatique) pour inclure, pour la première fois, l’exposition «secondaire» à des traumatismes. Le DSM-V (la bible des troubles psychiatriques) reconnaît dorénavant que les professionnels de première ligne (comme les policiers, les ambulanciers… et les journalistes, ajouterais-je) qui sont régulièrement témoins ou exposés indirectement à des détails scabreux ou des images explicites du traumatisme d’autrui sont eux-mêmes plus à risque de développer des blessures psychologiques.
Il est temps que l'industrie de l'information commence à en tenir compte afin de mieux nous protéger.
Pour commenter, vous pouvez joindre la conversation sur notre groupe Well-being In News
Vous voulez collaborer ou soumettre des suggestions? Contactez blog@journalismforum.ca
Dave Seglins est membre du Forum des journalistes canadiens sur la violence et le traumatisme et du Dart Center for Journalism & Trauma, et est un journaliste d'enquête chevronné à CBC News à Toronto.